« J’ai dit à Norris Drummond dans une interview réalisée dans les années 1960 que ma musique est une musique de révolte, une musique de révolte contre l’esclavage, contre les préjudices sociaux, contre le racisme, contre les inégalités, contre les discriminations économiques, contre le refus de nous donner notre chance et contre les injustices dont nous avons souffert à l’époque du colonialisme en Jamaïque. Nous avons été arrachés à l’Afrique où nos ancêtres étaient des rois et des reines et emmenés en Jamaïque par bateaux en tant qu’esclaves. Là, on nous a ôté nos noms, notre langue, notre culture, notre dieu et notre religion. Mais, la musique est l’âme de l’Afrique – son esprit, son ADN, son hérédité – et cela, ils ont été incapables de la conquérir, permettant ainsi la naissance d’une révolution culturelle en Jamaïque appelée ska : la mère, l’utérus qui a donné naissance au rocksteady et au reggae, notre véritable style de vie. »1
(Prince Buster, Miami, février 2000)
Le dépeuplement des campagnes et le phénomène d’urbanisation qui touchent la Jamaïque depuis la fin du 19ème siècle engendrent de manière indirecte l’émergence de ghettos et bidonvilles à Kingston dès les années 1930. Au sortir de la deuxième guerre mondiale, l’américanisation de la société jamaïcaine donne naissance aux sound systems dans les quartiers pauvres de Kingston. Vingt ans plus tard, au début des années 1960, ces sound systems permettent à la jeunesse des ghettos, puis à la Jamaïque toute entière, de découvrir le nouveau son à la mode reflétant l’euphorie suscitée par l’indépendance: le ska.
Le dépeuplement des campagnes et l’émergence des ghettos et bidonvilles
À la fin du 19ème siècle, les Jamaïcains, désormais libres depuis le 1er août 1838, sont de plus en plus nombreux à quitter leurs campagnes pour l’étranger. Les destinations de prédilection sont à l’époque les îles avoisinantes des Caraïbes, l’Amérique du Sud, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Selon Philip Sherlock et Hazel Bennett, auteurs de The Story of the Jamaican People, « plus de 146 000 Jamaïcains, pratiquement tous ruraux, émigrent à l’étranger entre 1880 et 1920»2. Hormis l’étranger, les populations rurales migrent également à Kingston, la nouvelle capitale de l’île depuis 1872. Ce phénomène de dépeuplement des campagnes est particulièrement important du début des années 1870 à la fin des années 1940, mais il l’est davantage dès 1920. D’après Ken Post, « entre 1920 et la fin de la seconde guerre mondiale, la population de Kingston est passée de 63 700 à 110 100 habitants et la région de St. Andrew de 54 600 à 128 200 habitants»3. Que traduit cet exode rural ? Il est une réponse à la crise de l’emploi dans les régions rurales. Le crash financier de 1929 et le cyclone qui frappe la Jamaïque en 1930 ne font qu’aggraver la situation, aboutissant à une importante récession économique dans l’industrie agricole. Ainsi, lorsque les activités cessent dans les fermes et les mines de bauxite de Trelawny, Saint Elizabeth ou Clarendon, les Jamaïcains sont nombreux à aller tenter leur chance à Kingston. De la même manière, lorsque des milliers de Jamaïcains expatriés aux Etats-Unis, en Angleterre, à Cuba ou Panama rentrent au pays dans les années 1930 (diverses raisons expliquent ce retour de milliers de Jamaïcains dans les années 1930 : crise économique affectant le pays d’accueil, terme de leur contrat etc.), ils s’installent à Kingston dans l’espoir de trouver du travail. Malheureusement, peu d’entre eux ont l’opportunité de trouver une activité rentable dans cette capitale surpeuplée, le marché du travail étant désormais saturé.
De plus, à la pénurie d’emplois s’ajoute un manque accru d’habitations et d’infrastructures. Les ghettos et bidonvilles se développent à une vitesse incroyable dans le Kingston des années 1930, dans la partie ouest de la capitale notamment. Par conséquent, à défaut de trouver une vie prospère à la ville, la grande majorité de ces nouveaux habitants n’y trouve que misère, pauvreté et insalubrité. Ainsi naissent au fil du temps les bidonvilles et ghettos de Ackee Walk, Back-A-Wall, Jones Town ou Trench Town, parmi tant d’autres, au sein desquels les sound systems et le ska apparaissent respectivement à la fin des années 1940 et au début des années 1960. Notons que le renforcement des lois anti-immigration aux Etats-Unis (l’Immigration and Nationality Act est voté en 1952 et favorise l’immigration provenant des pays d’Europe de l’est au dépit de celle issue des Caraïbes) et au Royaume-Uni (le Commonwealth Immigration Act est voté en 1962 ; il empêche les populations des anciennes colonies britanniques, dont les Jamaïcains font partie, de venir s’installer au Royaume-Uni) renforce aussi cette tendance à l’exode vers Kingston.
L’américanisation de la société jamaïcaine
Pendant la deuxième guerre mondiale, alors que les liens politiques entre la Jamaïque et la Grande-Bretagne perdent de leur ténacité, l’île se rapproche de plus en plus des Etats-Unis autant d’un point de vue politique que culturel. De plus, le contact direct avec les Américains, le développement et l’expansion des techniques de communication ainsi que l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays intensifient l’intérêt des Jamaïcains pour la musique américaine, notamment le jazz et le rhythm and blues.
Les bases militaires américaines
Dans les années 1950, il reste deux bases militaires américaines en Jamaïque, l’une à Sandy Gully et l’autre à Vernon Fields. Ces bases permettent aux Jamaïcains de rencontrer des soldats et marins américains, et ainsi d’être exposés à leur culture musicale : le jazz et le rhythm and blues.
Le jazz, le rhythm and blues américain, la radio et les sound systems
Le jazz (Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong, Glenn Miller), déjà présent sur l’île depuis les années 1930, connaît un succès croissant après la seconde guerre mondiale. Alors que les groupes de mento ou calypso jamaïcain se produisent dans les hôtels chics de l’île, des formations de jazz font leur apparition dans les quartiers pauvres de la capitale. Un bon nombre d’entre-elles gagnent en popularité grâce au talent des saxophonistes Eric Dean et Val Bennett, du tromboniste Don Drummond (le préféré d’Ella Fitzgerald), du guitariste Ernest Ranglin et des trompettistes Johnnie « Dizzy » Moore et Oswald « Baba » Brooks parmi tant d’autres. Notons que la plupart de ces musiciens reçoivent à l’époque la même formation musicale, à savoir celle de l’Alpha Boys’ School. Au début des années 1950, l’orchestre d’Eric Dean se produit régulièrement dans différents clubs de Kingston tel que le Colony Club de Halfway Tree. Quant au premier grand concert de jazz, il a lieu au Ward Theatre de Kingston en 1954. A cette époque, le jazz n’est pas la seule musique appréciée des habitants de Kingston.
Le rhythm and blues, le swing et le rock’n’roll sont également très populaires chez les jeunes, fans des derniers tubes de Fats Domino, Louis Jordan, Amos Milburn, Roscoe Gordon, Brook Benton, Aretha Franklin, Curtis Mayfield et autres Ray Charles. Pour les Jamaïcains majoritairement pauvres et sans emploi ces nouveaux styles musicaux, plus en phase avec leur époque que le mento, sont un moyen d’échapper à la triste réalité du quotidien. L’heure de gloire du mento jamaïcain prend fin avec l’explosion du rhythm and blues au milieu des années 1950.
 Aretha Franklin et Ray Charles. Photo :
Aretha Franklin et Ray Charles. Photo : www.altmanphoto.com/RayCharlesArethaFranklin.jpeg
Ce nouveau style musical est perçu par l’ensemble des Jamaïcains, la jeunesse en particulier, comme beaucoup plus moderne, urbain et dansant que le mento considéré comme un style obsolète et provincial. Toutefois, Kevin O’Brien Chang et Wayne Chen soulignent que « bien que la plupart des gens étaient fans de [ces nouveaux styles musicaux], la majorité des boites de nuits et salles de concerts étaient réservés à la bourgeoisie. Les autres étaient exclus de tels endroits »4. Les plus démunis, c’est-à-dire la majorité de la population, se tournent alors vers deux moyens de communication en plein essor dans cette Jamaïque des années 1950 : la radio et le sound system. En effet, l’apparition de la radio bouleverse la vie des jamaïcains. Après avoir passé la journée à courir après quelques billets, les plus pauvres se réunissent la nuit dans un yard autour d’un poste radio pour écouter les derniers tubes afro-américains programmés par les deux seules radios locales : la Radio Jamaica Rediffusion (RJR), fondée en 1950, et la Jamaica Broadcasting Corporation (JBC), fondée en 1959. De même, quand les conditions climatiques le permettent, ils se branchent sur des stations de Nashville, de la Nouvelle-Orléans (WONE) et de Miami (WINZ) qui n’hésitent pas à programmer la crème du rhythm and blues noir américain. Notons que dans une île touchée par un chômage en pleine croissance, peu de Jamaïcains possèdent un poste radio à cette époque. Au début des années 1950, moins de 20% des foyers jamaïcains possèdent une radio contre 90% au début des années 1960 (cette augmentation est en partie due à l’électrification progressive des ghettos et bidonvilles).
Outre la radio, les sound systems jouent un rôle significatif pour ce qui est de la diffusion du rhythm and blues au quatre coins de l’île. En effet, les importations de matériel hi°fi (il s’agit principalement de matériel de base, à savoir des tourne-disques, des haut-parleurs et des disques) sont en pleine croissance depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Dès la fin des années 1940, des soirées s’organisent donc à Kingston dans un premier temps puis dans l’île toute entière autour de sonos mobiles plus connues sous le nom de sound systems. Révolution sociale à part entière, la culture du sound system se développe de manière phénoménale pour des raisons bien précises. D’une part, comme mentionné précédemment, au milieu des années 1950 la radio, à l’instar des salles de spectacles ou des discothèques, reste encore un luxe pour de nombreux jamaïcains. D’autre part, les deux seules radios locales (RJR et JBC) ne reflètent pas complètement les goûts et préférences des jeunes jamaïcains. Entièrement contrôlées par le gouvernement jamaïcain, elles programment des artistes tels que Jim Reeves, Bing Crosby ou Frank Sinatra plutôt que Ray Charles ou Aretha Franklin. Elles sont donc considérées comme étant trop conservatrices, trop politiquement correctes, voire trop « blanches » par les jeunes des ghettos. Ces derniers préfèrent donc se tourner dès qu’ils le peuvent vers les sound systems dans lesquels la censure n’existe pas et dont les droits d’entrée sont accessibles à tous. De plus, la musique y est définitivement entraînante, excitante et plus que jamais « black ». Les premiers propriétaires de sound systems de l’île s’appellent Tom The Great Sebastian qui contrôle Luke Lane et Charles Street ; Count Smith installé à Greenwich Town ; V Rocket ; Sir Nick ; Admiral Cosmic et Lord Koos. Mais, c’est la deuxième vague d’operators (operator est le terme anglais désignant le propriétaire d’un sound system) vers la fin des années 1950 qui va véritablement révolutionner et influencer l’histoire de la musique jamaïcaine. Agés de moins de vingt ans pour la plupart, ces operators ont grandi avec l’idée que ces discothèques ambulantes sont indissociables de la vie culturelle jamaïcaine. À la différence de leurs prédécesseurs qui ne maîtrisaient pas pleinement ce nouveau concept et qui devaient fournir de gros efforts afin de fidéliser leur public, cette seconde génération d’operators peut concentrer ses efforts sur le perfectionnement et la maximalisation du sound system devenu un outil à la fois social et commercial.
Clement Dodd alias «
Coxsone », Arthur « Duke » Reid, Vincent « King » Edwards et l’innovateur Cecil Campbell alias
Prince Buster respectivement à la tête des sound systems Sir Coxsone’s Downbeat,
Trojan, Giant et Voice of the People, sont les piliers de cette nouvelle vague. Du milieu des années 1950 à la fin des années 1960, ils règnent en maîtres sur la vie nocturne des ghettos, se menant une guerre sans merci et ayant recours à la violence lorsqu’il le faut pour s’approprier les faveurs du public (
Duke Reid, ancien agent de police, est par exemple réputé pour ses méthodes musclées d’intimidation ; il est couronné roi du « Sound and Blues » sur Beat Street de 1956 à 1958). Ils sont également les premiers à produire et à programmer dans leurs sound systems des artistes locaux de rhythm and blues, puis de ska, style musical qui naît d’un mélange de rhythm and blues jamaïcain, de jazz et de mento.
Duke Reid couronné roi du « Sound and Blues ». Photo : http://www.azevedo.ca/scratch/images/duke_reid_success_club_late_1950s.jpg
 La naissance du ska
Du rhythm and blues américain au rhythm and blues jamaïcain
La naissance du ska
Du rhythm and blues américain au rhythm and blues jamaïcain
La déferlante de rhythm and blues, qui a tant marqué les Etats-Unis puis la Jamaïque, s’essouffle mystérieusement vers la fin des années 1950, avant de complètement disparaître de la scène musicale au début des années 1960. Or, à l’aube de l’indépendance de l’île, les sound systems sont dépendants de cette musique noire américaine pour continuer à faire danser et rêver la jeunesse jamaïcaine. Afin de pallier à ce manque, les propriétaires de sound systems tels que
Coxsone, Reid ou
Prince Buster enregistrent des groupes locaux de rhythm and blues dès la fin des années 1950. Ces enregistrements sont immédiatement pressés sur vinyles afin d’être diffusés dans les sounds systems (à cette époque, le pressage des disques a lieu à Federal Records, compagnie détenue par Ken Khouri). Le rhythm and blues jamaïcain se diffère de son modèle américain à plusieurs niveaux. D’une part, on y retrouve des influences venant du traditionnel mento et des musiques latines telles que le merengue dominicain et le calypso de Trinité-Et-Tobago, lesquelles sont complètement absentes du rhythm and blues américain. D’autre part, le rhythm and blues jamaïcain étant à l’origine créé pour être joué en sound systems, les lignes de basse sont volontairement accentuées afin de faire vibrer le public. Enfin, contrairement aux chanteurs de rhythm and blues américain qui puisent leurs inspirations dans le gospel issu du protestantisme d’Amérique du Nord, les chanteurs de rhythm and blues jamaïcain s’inspirent du gospel des églises revivalistes (le Revival est une religion née dans les années 1860 en Jamaïque combinant des pratiques animistes africaines avec des éléments de la religion chrétienne). Lloyd « Bunny » Robinson et Noel « Skully » Simms, plus connus sous le nom de Bunny & Skully, font partie des premiers artistes jamaïcains à faire du rhythm and blues. Ils sont notamment produits par Stanley Motta et Ken Khouri.
Derrick Morgan, Owen Gray, Wilfred « Jackie» Edwards, Eric « Monty » Morris, Hortense Ellis (la sœur d’
Alton Ellis qui est à l’époque danseur), Laurel Aitken, Joe Higgs et Roy Wilson (Higgs & Wilson) parmi tant d’autres font également partie de cette génération de pionniers du rhythm and blues jamaïcain. En 1959, c’est Chris Blackwell qui produit le légendaire hit de Laurel Aitken, « Boogie In My Bones ».
Quant à Higgs & Wilson, ils enregistrent une série de tubes pour Edward Seaga (alors patron de West Indian Record Limited) dont le fabuleux « Manny Oh » (1960),
Coxsone,
Prince Buster et
Duke Reid. Ce dernier crée également son propre groupe, The
Duke Reid Band, dans lequel les prodigieux musiciens de jazz
Rico Rodriguez, Don Drummond, Roland Alphonso, Johnny « Dizzy » Moore et Ernest Ranglin font des apparitions ponctuelles. Les Blues Busters, avec à leur tête le contrebassiste Cluett Johnson alias Clue J, enregistrent quant à eux exclusivement pour
Coxsone Dodd.
 « Skully » Simms en concert avec les Jamaica All Stars à Saint Ménehould
« Skully » Simms en concert avec les Jamaica All Stars à Saint Ménehould Photo by Jérémie Kroubo
Du rhythm and blues jamaïcain au ska
Ernest Ranglin et
Rico Rodriguez jouent aussi occasionnellement au sein des Blues Busters aux côtés de Theophilius Beckford ou du fantastique pianiste âgé de seulement 14 ans Monty Alexander. Les Blues Busters, sortant pour la plupart de l’Alpha Boys’ School et accompagnant couramment des groupes de mento ou de jazz, accentuent les rythmes de mento et les influences jazz du rhythm and blues jamaïcain pour créer un nouveau style de musique. Initialement appelé shuffle, ce dernier devient le ska, véritable fer de lance d’une nouvelle culture urbaine et précurseur du rocksteady et du reggae. Comme le mento auparavant, le ska naît d’un brassage de diverses influences musicales tel que l’explique Bunny Lee dans Reggae-Deep Roots Music:
« On a combiné le mento et le jazz pour produire un nouveau style initialement appelé shuffle. […] Les studios d’enregistrement qui venaient de voir le jour étaient toujours à la recherche de nouveaux sons. Avec les artistes de rhythm and blues américains tels que Fats Domino et Louis Jordan, les musiciens jamaïcains ont intégré des lignes de basse de boogie-woogie ainsi que des notes de blues. On a aussi fortement accentué le contretemps du mento. Les contretemps sont devenus de plus en plus courts et de plus en plus distants. On jouait ces nouveaux rythmes syncopés à la guitare et au piano. Ce nouveau style de musique s’est fait connaître sous le nom de ska. La première personne à avoir enregistré ce rythme « ska » est Ernest Ranglin lorsqu’il jouait avec Cluett Johnson (Clue J.) et les Blues Busters. Un jour il essayait de faire sortir un son de sa guitare et il a dit « fait la sonner ska !ska !ska ! ». Et c’est ainsi que le nom « ska » est né. »5.
De nombreuses critiques affirment que « Oh Carolina » (1961) des Folkes Brothers (le trio composé de John, Mico et Junior Folkes), produit par
Prince Buster, est la première chanson typiquement ska. À noter que cette chanson se distingue comme étant le premier single jamaïcain incluant des percussions rastas ou nyabinghi (jouées par Count Ossie). D’autres attestent au contraire que c’est la chanson « Easy Snapin » (1959) de Theophilus Beckford, produite par
Coxsone quelques années plus tôt, qui est le premier morceau véritablement ska. Quoiqu’il en soit, au début des années 1960, le ska devient rapidement le style musical jamaïcain à la mode. Il symbolise l’identité musicale de l’île et son succès coïncide avec l’indépendance de la Jamaïque en 1962. Parmi les autres grandes figures du ska on peut également citer de manière non exhaustive :
Derrick Morgan, Lord Creator, Eric Morris, Laurel Aitken, Millie Small,
Jimmy Cliff, Toots & The Maytals, Byron Lee et les Dragonnaires, les
Wailers, sans oublier les très célèbres
Skatalites. Notons qu’à l’instar du rhythm and blues, le ska est très largement popularisé par la culture du sound system.

Pochette de l’album Never Grow Old des Maytals (
Coxsone : 1963).
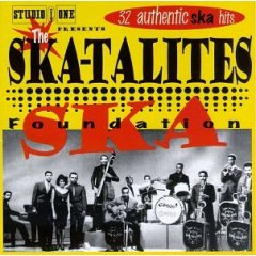
Pochette de l’album Foundation Ska des
Skatalites (Studio One : 1996).
NOTES
1) BUSTER, Prince in BRADLEY, Lloyd, 2000, Bass
Culture, Londres, Penguin Books, XV (Foreword). (Traduction personnelle).
2) BENNETT, Hazel, SHERLOCK, Philip, 1998, The Story of the Jamaican People, Kingston, Ian Randle Publishers, 348. (Traduction personnelle).
3) POST, Ken, 1978, Arise Ye Starvelings :The Jamaican Labour Rebellion of 1938 and Its Aftermath, Vol. 2, La Haye, Matinus Nijhoff, 132. (Traduction personnelle).
4) CHANG, Kevin O’Brien, CHEN, Wayne Chen, 1998, Reggae Routes: The Story of Jamaican Music, Kingston, Ian Randle Publishers, 15-16. (Traduction personnelle).
5) LEE, Bunny in JOHNSON, Howard, Pines, Jim, 1982, Reggae-Deep Roots Music, Londres, Proteus, 1982, 49. (Traduction personnelle).
 Aretha Franklin et Ray Charles. Photo : www.altmanphoto.com/RayCharlesArethaFranklin.jpeg
Ce nouveau style musical est perçu par l’ensemble des Jamaïcains, la jeunesse en particulier, comme beaucoup plus moderne, urbain et dansant que le mento considéré comme un style obsolète et provincial. Toutefois, Kevin O’Brien Chang et Wayne Chen soulignent que « bien que la plupart des gens étaient fans de [ces nouveaux styles musicaux], la majorité des boites de nuits et salles de concerts étaient réservés à la bourgeoisie. Les autres étaient exclus de tels endroits »4. Les plus démunis, c’est-à-dire la majorité de la population, se tournent alors vers deux moyens de communication en plein essor dans cette Jamaïque des années 1950 : la radio et le sound system. En effet, l’apparition de la radio bouleverse la vie des jamaïcains. Après avoir passé la journée à courir après quelques billets, les plus pauvres se réunissent la nuit dans un yard autour d’un poste radio pour écouter les derniers tubes afro-américains programmés par les deux seules radios locales : la Radio Jamaica Rediffusion (RJR), fondée en 1950, et la Jamaica Broadcasting Corporation (JBC), fondée en 1959. De même, quand les conditions climatiques le permettent, ils se branchent sur des stations de Nashville, de la Nouvelle-Orléans (WONE) et de Miami (WINZ) qui n’hésitent pas à programmer la crème du rhythm and blues noir américain. Notons que dans une île touchée par un chômage en pleine croissance, peu de Jamaïcains possèdent un poste radio à cette époque. Au début des années 1950, moins de 20% des foyers jamaïcains possèdent une radio contre 90% au début des années 1960 (cette augmentation est en partie due à l’électrification progressive des ghettos et bidonvilles).
Outre la radio, les sound systems jouent un rôle significatif pour ce qui est de la diffusion du rhythm and blues au quatre coins de l’île. En effet, les importations de matériel hi°fi (il s’agit principalement de matériel de base, à savoir des tourne-disques, des haut-parleurs et des disques) sont en pleine croissance depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Dès la fin des années 1940, des soirées s’organisent donc à Kingston dans un premier temps puis dans l’île toute entière autour de sonos mobiles plus connues sous le nom de sound systems. Révolution sociale à part entière, la culture du sound system se développe de manière phénoménale pour des raisons bien précises. D’une part, comme mentionné précédemment, au milieu des années 1950 la radio, à l’instar des salles de spectacles ou des discothèques, reste encore un luxe pour de nombreux jamaïcains. D’autre part, les deux seules radios locales (RJR et JBC) ne reflètent pas complètement les goûts et préférences des jeunes jamaïcains. Entièrement contrôlées par le gouvernement jamaïcain, elles programment des artistes tels que Jim Reeves, Bing Crosby ou Frank Sinatra plutôt que Ray Charles ou Aretha Franklin. Elles sont donc considérées comme étant trop conservatrices, trop politiquement correctes, voire trop « blanches » par les jeunes des ghettos. Ces derniers préfèrent donc se tourner dès qu’ils le peuvent vers les sound systems dans lesquels la censure n’existe pas et dont les droits d’entrée sont accessibles à tous. De plus, la musique y est définitivement entraînante, excitante et plus que jamais « black ». Les premiers propriétaires de sound systems de l’île s’appellent Tom The Great Sebastian qui contrôle Luke Lane et Charles Street ; Count Smith installé à Greenwich Town ; V Rocket ; Sir Nick ; Admiral Cosmic et Lord Koos. Mais, c’est la deuxième vague d’operators (operator est le terme anglais désignant le propriétaire d’un sound system) vers la fin des années 1950 qui va véritablement révolutionner et influencer l’histoire de la musique jamaïcaine. Agés de moins de vingt ans pour la plupart, ces operators ont grandi avec l’idée que ces discothèques ambulantes sont indissociables de la vie culturelle jamaïcaine. À la différence de leurs prédécesseurs qui ne maîtrisaient pas pleinement ce nouveau concept et qui devaient fournir de gros efforts afin de fidéliser leur public, cette seconde génération d’operators peut concentrer ses efforts sur le perfectionnement et la maximalisation du sound system devenu un outil à la fois social et commercial.
Clement Dodd alias « Coxsone », Arthur « Duke » Reid, Vincent « King » Edwards et l’innovateur Cecil Campbell alias Prince Buster respectivement à la tête des sound systems Sir Coxsone’s Downbeat, Trojan, Giant et Voice of the People, sont les piliers de cette nouvelle vague. Du milieu des années 1950 à la fin des années 1960, ils règnent en maîtres sur la vie nocturne des ghettos, se menant une guerre sans merci et ayant recours à la violence lorsqu’il le faut pour s’approprier les faveurs du public (Duke Reid, ancien agent de police, est par exemple réputé pour ses méthodes musclées d’intimidation ; il est couronné roi du « Sound and Blues » sur Beat Street de 1956 à 1958). Ils sont également les premiers à produire et à programmer dans leurs sound systems des artistes locaux de rhythm and blues, puis de ska, style musical qui naît d’un mélange de rhythm and blues jamaïcain, de jazz et de mento.
Duke Reid couronné roi du « Sound and Blues ». Photo : http://www.azevedo.ca/scratch/images/duke_reid_success_club_late_1950s.jpg
Aretha Franklin et Ray Charles. Photo : www.altmanphoto.com/RayCharlesArethaFranklin.jpeg
Ce nouveau style musical est perçu par l’ensemble des Jamaïcains, la jeunesse en particulier, comme beaucoup plus moderne, urbain et dansant que le mento considéré comme un style obsolète et provincial. Toutefois, Kevin O’Brien Chang et Wayne Chen soulignent que « bien que la plupart des gens étaient fans de [ces nouveaux styles musicaux], la majorité des boites de nuits et salles de concerts étaient réservés à la bourgeoisie. Les autres étaient exclus de tels endroits »4. Les plus démunis, c’est-à-dire la majorité de la population, se tournent alors vers deux moyens de communication en plein essor dans cette Jamaïque des années 1950 : la radio et le sound system. En effet, l’apparition de la radio bouleverse la vie des jamaïcains. Après avoir passé la journée à courir après quelques billets, les plus pauvres se réunissent la nuit dans un yard autour d’un poste radio pour écouter les derniers tubes afro-américains programmés par les deux seules radios locales : la Radio Jamaica Rediffusion (RJR), fondée en 1950, et la Jamaica Broadcasting Corporation (JBC), fondée en 1959. De même, quand les conditions climatiques le permettent, ils se branchent sur des stations de Nashville, de la Nouvelle-Orléans (WONE) et de Miami (WINZ) qui n’hésitent pas à programmer la crème du rhythm and blues noir américain. Notons que dans une île touchée par un chômage en pleine croissance, peu de Jamaïcains possèdent un poste radio à cette époque. Au début des années 1950, moins de 20% des foyers jamaïcains possèdent une radio contre 90% au début des années 1960 (cette augmentation est en partie due à l’électrification progressive des ghettos et bidonvilles).
Outre la radio, les sound systems jouent un rôle significatif pour ce qui est de la diffusion du rhythm and blues au quatre coins de l’île. En effet, les importations de matériel hi°fi (il s’agit principalement de matériel de base, à savoir des tourne-disques, des haut-parleurs et des disques) sont en pleine croissance depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Dès la fin des années 1940, des soirées s’organisent donc à Kingston dans un premier temps puis dans l’île toute entière autour de sonos mobiles plus connues sous le nom de sound systems. Révolution sociale à part entière, la culture du sound system se développe de manière phénoménale pour des raisons bien précises. D’une part, comme mentionné précédemment, au milieu des années 1950 la radio, à l’instar des salles de spectacles ou des discothèques, reste encore un luxe pour de nombreux jamaïcains. D’autre part, les deux seules radios locales (RJR et JBC) ne reflètent pas complètement les goûts et préférences des jeunes jamaïcains. Entièrement contrôlées par le gouvernement jamaïcain, elles programment des artistes tels que Jim Reeves, Bing Crosby ou Frank Sinatra plutôt que Ray Charles ou Aretha Franklin. Elles sont donc considérées comme étant trop conservatrices, trop politiquement correctes, voire trop « blanches » par les jeunes des ghettos. Ces derniers préfèrent donc se tourner dès qu’ils le peuvent vers les sound systems dans lesquels la censure n’existe pas et dont les droits d’entrée sont accessibles à tous. De plus, la musique y est définitivement entraînante, excitante et plus que jamais « black ». Les premiers propriétaires de sound systems de l’île s’appellent Tom The Great Sebastian qui contrôle Luke Lane et Charles Street ; Count Smith installé à Greenwich Town ; V Rocket ; Sir Nick ; Admiral Cosmic et Lord Koos. Mais, c’est la deuxième vague d’operators (operator est le terme anglais désignant le propriétaire d’un sound system) vers la fin des années 1950 qui va véritablement révolutionner et influencer l’histoire de la musique jamaïcaine. Agés de moins de vingt ans pour la plupart, ces operators ont grandi avec l’idée que ces discothèques ambulantes sont indissociables de la vie culturelle jamaïcaine. À la différence de leurs prédécesseurs qui ne maîtrisaient pas pleinement ce nouveau concept et qui devaient fournir de gros efforts afin de fidéliser leur public, cette seconde génération d’operators peut concentrer ses efforts sur le perfectionnement et la maximalisation du sound system devenu un outil à la fois social et commercial.
Clement Dodd alias « Coxsone », Arthur « Duke » Reid, Vincent « King » Edwards et l’innovateur Cecil Campbell alias Prince Buster respectivement à la tête des sound systems Sir Coxsone’s Downbeat, Trojan, Giant et Voice of the People, sont les piliers de cette nouvelle vague. Du milieu des années 1950 à la fin des années 1960, ils règnent en maîtres sur la vie nocturne des ghettos, se menant une guerre sans merci et ayant recours à la violence lorsqu’il le faut pour s’approprier les faveurs du public (Duke Reid, ancien agent de police, est par exemple réputé pour ses méthodes musclées d’intimidation ; il est couronné roi du « Sound and Blues » sur Beat Street de 1956 à 1958). Ils sont également les premiers à produire et à programmer dans leurs sound systems des artistes locaux de rhythm and blues, puis de ska, style musical qui naît d’un mélange de rhythm and blues jamaïcain, de jazz et de mento.
Duke Reid couronné roi du « Sound and Blues ». Photo : http://www.azevedo.ca/scratch/images/duke_reid_success_club_late_1950s.jpg
 La naissance du ska
Du rhythm and blues américain au rhythm and blues jamaïcain
La déferlante de rhythm and blues, qui a tant marqué les Etats-Unis puis la Jamaïque, s’essouffle mystérieusement vers la fin des années 1950, avant de complètement disparaître de la scène musicale au début des années 1960. Or, à l’aube de l’indépendance de l’île, les sound systems sont dépendants de cette musique noire américaine pour continuer à faire danser et rêver la jeunesse jamaïcaine. Afin de pallier à ce manque, les propriétaires de sound systems tels que Coxsone, Reid ou Prince Buster enregistrent des groupes locaux de rhythm and blues dès la fin des années 1950. Ces enregistrements sont immédiatement pressés sur vinyles afin d’être diffusés dans les sounds systems (à cette époque, le pressage des disques a lieu à Federal Records, compagnie détenue par Ken Khouri). Le rhythm and blues jamaïcain se diffère de son modèle américain à plusieurs niveaux. D’une part, on y retrouve des influences venant du traditionnel mento et des musiques latines telles que le merengue dominicain et le calypso de Trinité-Et-Tobago, lesquelles sont complètement absentes du rhythm and blues américain. D’autre part, le rhythm and blues jamaïcain étant à l’origine créé pour être joué en sound systems, les lignes de basse sont volontairement accentuées afin de faire vibrer le public. Enfin, contrairement aux chanteurs de rhythm and blues américain qui puisent leurs inspirations dans le gospel issu du protestantisme d’Amérique du Nord, les chanteurs de rhythm and blues jamaïcain s’inspirent du gospel des églises revivalistes (le Revival est une religion née dans les années 1860 en Jamaïque combinant des pratiques animistes africaines avec des éléments de la religion chrétienne). Lloyd « Bunny » Robinson et Noel « Skully » Simms, plus connus sous le nom de Bunny & Skully, font partie des premiers artistes jamaïcains à faire du rhythm and blues. Ils sont notamment produits par Stanley Motta et Ken Khouri. Derrick Morgan, Owen Gray, Wilfred « Jackie» Edwards, Eric « Monty » Morris, Hortense Ellis (la sœur d’Alton Ellis qui est à l’époque danseur), Laurel Aitken, Joe Higgs et Roy Wilson (Higgs & Wilson) parmi tant d’autres font également partie de cette génération de pionniers du rhythm and blues jamaïcain. En 1959, c’est Chris Blackwell qui produit le légendaire hit de Laurel Aitken, « Boogie In My Bones ».
Quant à Higgs & Wilson, ils enregistrent une série de tubes pour Edward Seaga (alors patron de West Indian Record Limited) dont le fabuleux « Manny Oh » (1960), Coxsone, Prince Buster et Duke Reid. Ce dernier crée également son propre groupe, The Duke Reid Band, dans lequel les prodigieux musiciens de jazz Rico Rodriguez, Don Drummond, Roland Alphonso, Johnny « Dizzy » Moore et Ernest Ranglin font des apparitions ponctuelles. Les Blues Busters, avec à leur tête le contrebassiste Cluett Johnson alias Clue J, enregistrent quant à eux exclusivement pour Coxsone Dodd.
La naissance du ska
Du rhythm and blues américain au rhythm and blues jamaïcain
La déferlante de rhythm and blues, qui a tant marqué les Etats-Unis puis la Jamaïque, s’essouffle mystérieusement vers la fin des années 1950, avant de complètement disparaître de la scène musicale au début des années 1960. Or, à l’aube de l’indépendance de l’île, les sound systems sont dépendants de cette musique noire américaine pour continuer à faire danser et rêver la jeunesse jamaïcaine. Afin de pallier à ce manque, les propriétaires de sound systems tels que Coxsone, Reid ou Prince Buster enregistrent des groupes locaux de rhythm and blues dès la fin des années 1950. Ces enregistrements sont immédiatement pressés sur vinyles afin d’être diffusés dans les sounds systems (à cette époque, le pressage des disques a lieu à Federal Records, compagnie détenue par Ken Khouri). Le rhythm and blues jamaïcain se diffère de son modèle américain à plusieurs niveaux. D’une part, on y retrouve des influences venant du traditionnel mento et des musiques latines telles que le merengue dominicain et le calypso de Trinité-Et-Tobago, lesquelles sont complètement absentes du rhythm and blues américain. D’autre part, le rhythm and blues jamaïcain étant à l’origine créé pour être joué en sound systems, les lignes de basse sont volontairement accentuées afin de faire vibrer le public. Enfin, contrairement aux chanteurs de rhythm and blues américain qui puisent leurs inspirations dans le gospel issu du protestantisme d’Amérique du Nord, les chanteurs de rhythm and blues jamaïcain s’inspirent du gospel des églises revivalistes (le Revival est une religion née dans les années 1860 en Jamaïque combinant des pratiques animistes africaines avec des éléments de la religion chrétienne). Lloyd « Bunny » Robinson et Noel « Skully » Simms, plus connus sous le nom de Bunny & Skully, font partie des premiers artistes jamaïcains à faire du rhythm and blues. Ils sont notamment produits par Stanley Motta et Ken Khouri. Derrick Morgan, Owen Gray, Wilfred « Jackie» Edwards, Eric « Monty » Morris, Hortense Ellis (la sœur d’Alton Ellis qui est à l’époque danseur), Laurel Aitken, Joe Higgs et Roy Wilson (Higgs & Wilson) parmi tant d’autres font également partie de cette génération de pionniers du rhythm and blues jamaïcain. En 1959, c’est Chris Blackwell qui produit le légendaire hit de Laurel Aitken, « Boogie In My Bones ».
Quant à Higgs & Wilson, ils enregistrent une série de tubes pour Edward Seaga (alors patron de West Indian Record Limited) dont le fabuleux « Manny Oh » (1960), Coxsone, Prince Buster et Duke Reid. Ce dernier crée également son propre groupe, The Duke Reid Band, dans lequel les prodigieux musiciens de jazz Rico Rodriguez, Don Drummond, Roland Alphonso, Johnny « Dizzy » Moore et Ernest Ranglin font des apparitions ponctuelles. Les Blues Busters, avec à leur tête le contrebassiste Cluett Johnson alias Clue J, enregistrent quant à eux exclusivement pour Coxsone Dodd.
 « Skully » Simms en concert avec les Jamaica All Stars à Saint Ménehould Photo by Jérémie Kroubo
Du rhythm and blues jamaïcain au ska
Ernest Ranglin et Rico Rodriguez jouent aussi occasionnellement au sein des Blues Busters aux côtés de Theophilius Beckford ou du fantastique pianiste âgé de seulement 14 ans Monty Alexander. Les Blues Busters, sortant pour la plupart de l’Alpha Boys’ School et accompagnant couramment des groupes de mento ou de jazz, accentuent les rythmes de mento et les influences jazz du rhythm and blues jamaïcain pour créer un nouveau style de musique. Initialement appelé shuffle, ce dernier devient le ska, véritable fer de lance d’une nouvelle culture urbaine et précurseur du rocksteady et du reggae. Comme le mento auparavant, le ska naît d’un brassage de diverses influences musicales tel que l’explique Bunny Lee dans Reggae-Deep Roots Music:
« On a combiné le mento et le jazz pour produire un nouveau style initialement appelé shuffle. […] Les studios d’enregistrement qui venaient de voir le jour étaient toujours à la recherche de nouveaux sons. Avec les artistes de rhythm and blues américains tels que Fats Domino et Louis Jordan, les musiciens jamaïcains ont intégré des lignes de basse de boogie-woogie ainsi que des notes de blues. On a aussi fortement accentué le contretemps du mento. Les contretemps sont devenus de plus en plus courts et de plus en plus distants. On jouait ces nouveaux rythmes syncopés à la guitare et au piano. Ce nouveau style de musique s’est fait connaître sous le nom de ska. La première personne à avoir enregistré ce rythme « ska » est Ernest Ranglin lorsqu’il jouait avec Cluett Johnson (Clue J.) et les Blues Busters. Un jour il essayait de faire sortir un son de sa guitare et il a dit « fait la sonner ska !ska !ska ! ». Et c’est ainsi que le nom « ska » est né. »5.
De nombreuses critiques affirment que « Oh Carolina » (1961) des Folkes Brothers (le trio composé de John, Mico et Junior Folkes), produit par Prince Buster, est la première chanson typiquement ska. À noter que cette chanson se distingue comme étant le premier single jamaïcain incluant des percussions rastas ou nyabinghi (jouées par Count Ossie). D’autres attestent au contraire que c’est la chanson « Easy Snapin » (1959) de Theophilus Beckford, produite par Coxsone quelques années plus tôt, qui est le premier morceau véritablement ska. Quoiqu’il en soit, au début des années 1960, le ska devient rapidement le style musical jamaïcain à la mode. Il symbolise l’identité musicale de l’île et son succès coïncide avec l’indépendance de la Jamaïque en 1962. Parmi les autres grandes figures du ska on peut également citer de manière non exhaustive : Derrick Morgan, Lord Creator, Eric Morris, Laurel Aitken, Millie Small, Jimmy Cliff, Toots & The Maytals, Byron Lee et les Dragonnaires, les Wailers, sans oublier les très célèbres Skatalites. Notons qu’à l’instar du rhythm and blues, le ska est très largement popularisé par la culture du sound system.
« Skully » Simms en concert avec les Jamaica All Stars à Saint Ménehould Photo by Jérémie Kroubo
Du rhythm and blues jamaïcain au ska
Ernest Ranglin et Rico Rodriguez jouent aussi occasionnellement au sein des Blues Busters aux côtés de Theophilius Beckford ou du fantastique pianiste âgé de seulement 14 ans Monty Alexander. Les Blues Busters, sortant pour la plupart de l’Alpha Boys’ School et accompagnant couramment des groupes de mento ou de jazz, accentuent les rythmes de mento et les influences jazz du rhythm and blues jamaïcain pour créer un nouveau style de musique. Initialement appelé shuffle, ce dernier devient le ska, véritable fer de lance d’une nouvelle culture urbaine et précurseur du rocksteady et du reggae. Comme le mento auparavant, le ska naît d’un brassage de diverses influences musicales tel que l’explique Bunny Lee dans Reggae-Deep Roots Music:
« On a combiné le mento et le jazz pour produire un nouveau style initialement appelé shuffle. […] Les studios d’enregistrement qui venaient de voir le jour étaient toujours à la recherche de nouveaux sons. Avec les artistes de rhythm and blues américains tels que Fats Domino et Louis Jordan, les musiciens jamaïcains ont intégré des lignes de basse de boogie-woogie ainsi que des notes de blues. On a aussi fortement accentué le contretemps du mento. Les contretemps sont devenus de plus en plus courts et de plus en plus distants. On jouait ces nouveaux rythmes syncopés à la guitare et au piano. Ce nouveau style de musique s’est fait connaître sous le nom de ska. La première personne à avoir enregistré ce rythme « ska » est Ernest Ranglin lorsqu’il jouait avec Cluett Johnson (Clue J.) et les Blues Busters. Un jour il essayait de faire sortir un son de sa guitare et il a dit « fait la sonner ska !ska !ska ! ». Et c’est ainsi que le nom « ska » est né. »5.
De nombreuses critiques affirment que « Oh Carolina » (1961) des Folkes Brothers (le trio composé de John, Mico et Junior Folkes), produit par Prince Buster, est la première chanson typiquement ska. À noter que cette chanson se distingue comme étant le premier single jamaïcain incluant des percussions rastas ou nyabinghi (jouées par Count Ossie). D’autres attestent au contraire que c’est la chanson « Easy Snapin » (1959) de Theophilus Beckford, produite par Coxsone quelques années plus tôt, qui est le premier morceau véritablement ska. Quoiqu’il en soit, au début des années 1960, le ska devient rapidement le style musical jamaïcain à la mode. Il symbolise l’identité musicale de l’île et son succès coïncide avec l’indépendance de la Jamaïque en 1962. Parmi les autres grandes figures du ska on peut également citer de manière non exhaustive : Derrick Morgan, Lord Creator, Eric Morris, Laurel Aitken, Millie Small, Jimmy Cliff, Toots & The Maytals, Byron Lee et les Dragonnaires, les Wailers, sans oublier les très célèbres Skatalites. Notons qu’à l’instar du rhythm and blues, le ska est très largement popularisé par la culture du sound system.
 Pochette de l’album Never Grow Old des Maytals (Coxsone : 1963).
Pochette de l’album Never Grow Old des Maytals (Coxsone : 1963).
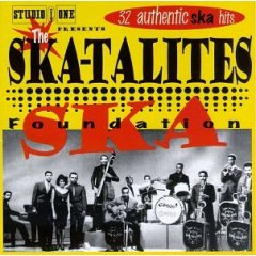 Pochette de l’album Foundation Ska des Skatalites (Studio One : 1996).
NOTES
1) BUSTER, Prince in BRADLEY, Lloyd, 2000, Bass Culture, Londres, Penguin Books, XV (Foreword). (Traduction personnelle).
2) BENNETT, Hazel, SHERLOCK, Philip, 1998, The Story of the Jamaican People, Kingston, Ian Randle Publishers, 348. (Traduction personnelle).
3) POST, Ken, 1978, Arise Ye Starvelings :The Jamaican Labour Rebellion of 1938 and Its Aftermath, Vol. 2, La Haye, Matinus Nijhoff, 132. (Traduction personnelle).
4) CHANG, Kevin O’Brien, CHEN, Wayne Chen, 1998, Reggae Routes: The Story of Jamaican Music, Kingston, Ian Randle Publishers, 15-16. (Traduction personnelle).
5) LEE, Bunny in JOHNSON, Howard, Pines, Jim, 1982, Reggae-Deep Roots Music, Londres, Proteus, 1982, 49. (Traduction personnelle).
Pochette de l’album Foundation Ska des Skatalites (Studio One : 1996).
NOTES
1) BUSTER, Prince in BRADLEY, Lloyd, 2000, Bass Culture, Londres, Penguin Books, XV (Foreword). (Traduction personnelle).
2) BENNETT, Hazel, SHERLOCK, Philip, 1998, The Story of the Jamaican People, Kingston, Ian Randle Publishers, 348. (Traduction personnelle).
3) POST, Ken, 1978, Arise Ye Starvelings :The Jamaican Labour Rebellion of 1938 and Its Aftermath, Vol. 2, La Haye, Matinus Nijhoff, 132. (Traduction personnelle).
4) CHANG, Kevin O’Brien, CHEN, Wayne Chen, 1998, Reggae Routes: The Story of Jamaican Music, Kingston, Ian Randle Publishers, 15-16. (Traduction personnelle).
5) LEE, Bunny in JOHNSON, Howard, Pines, Jim, 1982, Reggae-Deep Roots Music, Londres, Proteus, 1982, 49. (Traduction personnelle).















